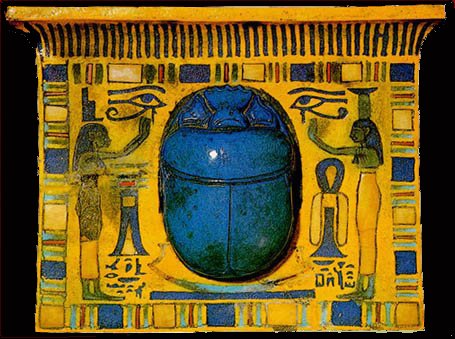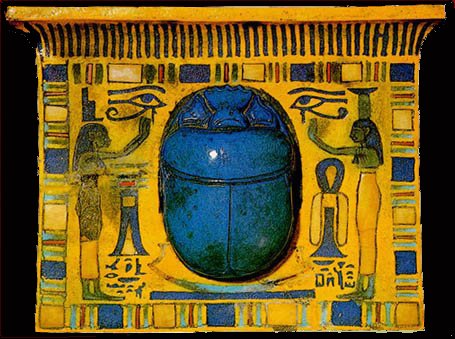Le symbole "scarabée" et son nom (Khéper
ou Khépri) définissent Ie sens égyptien de la
"genèse", celui qui lui est donné naturellement
en égyptologie. L'origine grecque du mot "genèse"
lui donne Ie sens de devenir, de production. Le Dictionnaire philosophique
de Lalande Ie définit en termes très clairs : "La
genèse d'un objet d'étude (par exemple d'un être,
d'une fonction, d'une institution) est la façon dont il est
devenu ce qu'il est au moment considéré, c'est-à-dire
la suite des formes successives qu'il a présentées,
considérées dans leur rapport avec les circonstances
où s'est produit ce développement."
La genèse d'une chose suppose donc des états successifs,
des transformations. Devenir, production transitoire, transformations
: on ne peut pas mieux traduire les significations connues du symbole
"scarabée", et des mots qu'il détermine :
kheper : être, exister, devenir, prendre forme ;
kheprer : le Créateur du Monde, qui se produit lui-même
;
khepera : Ie scarabée sacré. Le Neter
qui produit les formes de son existence.
kheprou : formes, transformations, etc.

 L'idée de "genèse", telle qu'elle est décrite
ci-dessus, est la fondation même de l'enseignement égyptien.
Elle affirme le principe du Créateur producteur de lui-même,
puis de toutes les formes dont il est la cause. Elle enseigne l'idée
des états d'être successifs, et des transformations qui
sont un des thèmes essentiels des textes funéraires.
L'idée de "genèse", telle qu'elle est décrite
ci-dessus, est la fondation même de l'enseignement égyptien.
Elle affirme le principe du Créateur producteur de lui-même,
puis de toutes les formes dont il est la cause. Elle enseigne l'idée
des états d'être successifs, et des transformations qui
sont un des thèmes essentiels des textes funéraires.
La légende du scarabée qui fait rouler sa boule réunit
les éléments d'un quadruple symbolisme :
1) La coïncidence des principes lunaire-solaire : Ie scarabée
aux deux élytres déployées est une figuration
égyptienne du soleil en son double mouvement, ascendant et
descendant. Enfouissant sa boule dans la terre pour y faire gester
sa semence, il figure Ie couchant de Râ qui "descend dans
sa montagne" ; il figure son lever lorsqu'il extrait sa boule
des ténèbres pour l'amener dans "l'eau de renaissance".
D'autre part, Ie scarabée est symbole des fonctions lunaires
par les 28 jours pendant lesquels il enterre sa boule.
2) La fécondation sans femelle, et la gestation dans les ténèbres,
c'est-à-dire dans la boule de fumier jetée ensuite dans
l'eau pour son éclosion. Ce scarabée, mâle sans
femelle, crée Ie milieu femelle par la bouse qui devient gestante
et nourrissante. Ce rôle lui donne Ie caractère de mâle
jouant, par un artifice, Ie rôle d'androgyne.
3) Le scarabée symbolise Ie principe de l'être qui réalise
par lui-même les éléments de son devenir et de
sa transformation. C'est pour cette raison que les Égyptiens
Ie posaient, sur les momies, à la place du cœur.
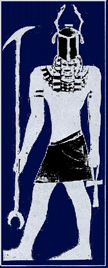 Khéper est souvent présent dans les vignettes du Livre des morts
appelé aussi: "Livre pour sortir au jour". Il est représenté sous l'aspect d'un homme à tête
de scarabée tenant dans la main droite le sceptre "Ouas" et dans la gauche "Ankh", la croix ansée de la vie.
Le scarabée s'y voit confier la lourde tâche de guider
Rê, le Soleil, dans son voyage nocturne à travers le
monde souterrain. Les Égyptiens, après avoir observé
les habitudes des coléoptères, pensaient que la boulette
que le scarabée poussait devant lui contenait, outre les excréments,
sa semence d'androgyne. On comprend alors qu'ils firent du scarabée
le symbole du pouvoir régénérateur du soleil.
Partout sur les murs des tombes, que ce soit à Thèbes
Ouest ou dans la nécropole de Memphis, les artistes représentèrent
Khéper poussant devant lui l'astre solaire jusqu'à ce
qu'il émerge à l'horizon d'un jour nouveau. Ce parcours
nocturne était assimilé à une navigation, aussi
trouve-t-on Khéper à bord de la
barque de Rê. Le scarabée symbolisa même le
Dieu solaire à son lever tandis qu'Atoum marquait l'état
de l'astre déclinant derrière les montages de l'Occident.
Khéper est souvent présent dans les vignettes du Livre des morts
appelé aussi: "Livre pour sortir au jour". Il est représenté sous l'aspect d'un homme à tête
de scarabée tenant dans la main droite le sceptre "Ouas" et dans la gauche "Ankh", la croix ansée de la vie.
Le scarabée s'y voit confier la lourde tâche de guider
Rê, le Soleil, dans son voyage nocturne à travers le
monde souterrain. Les Égyptiens, après avoir observé
les habitudes des coléoptères, pensaient que la boulette
que le scarabée poussait devant lui contenait, outre les excréments,
sa semence d'androgyne. On comprend alors qu'ils firent du scarabée
le symbole du pouvoir régénérateur du soleil.
Partout sur les murs des tombes, que ce soit à Thèbes
Ouest ou dans la nécropole de Memphis, les artistes représentèrent
Khéper poussant devant lui l'astre solaire jusqu'à ce
qu'il émerge à l'horizon d'un jour nouveau. Ce parcours
nocturne était assimilé à une navigation, aussi
trouve-t-on Khéper à bord de la
barque de Rê. Le scarabée symbolisa même le
Dieu solaire à son lever tandis qu'Atoum marquait l'état
de l'astre déclinant derrière les montages de l'Occident.
Le Scarabée sacré est également un signe hiéroglyphique
qui se rapporte à la transformation et au devenir ; les scribes
chargés de la duplication des nombreux rouleaux qui accompagnaient
les défunts bienheureux dans leur seconde vie devaient en dessiner
souvent. Par exemple, le titre du chapitre 76 du Livre des morts n'en
contient pas moins de trois sur une seule ligne : «Parole pour
se transformer en toutes apparences dans lesquelles on aimerait à
se changer.»
 De
nombreux scarabées de pierre nous sont parvenus sous Ie qualificatif
de "Scarabée de Cœur". Ils étaient placés
par les prêtres d'Anubis chargés de la momification,
près du cœur du défunt. Seul organe à être
replacé dans la momie, puisque le cœur était Ie
siège de l'âme et des sentiments.
De
nombreux scarabées de pierre nous sont parvenus sous Ie qualificatif
de "Scarabée de Cœur". Ils étaient placés
par les prêtres d'Anubis chargés de la momification,
près du cœur du défunt. Seul organe à être
replacé dans la momie, puisque le cœur était Ie
siège de l'âme et des sentiments.
Un texte gravé sous Ie ventre de ces scarabées, reprenait
le chapitre XXX du Livre des morts : «Formule
pour que Ie cœur du défunt ne s'oppose pas à lui
dans la nécropole. II dit : « Ô mon cœur de
ma mère, ô mon cœur de mes transformations, ne témoigne
pas contre moi, ne t'oppose pas à moi devant Ie tribunal, ne
te rebelle pas contre moi en présence du gardien de la balance...
»
Les anciens égyptiens n'avaient qu'un but dans la vie : partir
le cœur léger, et pour cela il fallait un esprit sain
et une âme pure. Au moment de la pesée
du cœur sur le plateaux de la balance de Thot, la vie du
défunt, symbolisée par son cœur, devait être
en parfait équilibre avec le principe de la justice, la plume
de Maât. La conscience spirituelle est
donc appelée "cœur". Dans le fond, cela se perpétue
jusqu'à nous dans de nombreuses expressions : cela va droit
au cœur, au fond de mon cœur, à votre bon cœur,
avoir le cœur gros, l'entente cordiale, de tout cœur avec
vous... "Le cœur a ses raisons que la raison ignore"
a écrit Blaise Pascal.
Khéper était parfois associé
également à Harmakhis, autre
Dieu solaire...